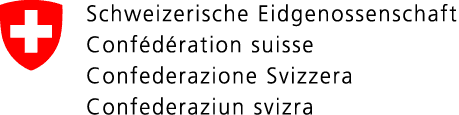Mesures de coercition à des fins d’assistance et placements extrafamiliaux. Une vue d’ensemble
Pendant des décennies, les autorités suisses ont profondément bouleversé la vie de centaines de milliers de personnes en recourant à des « mesures de coercition à des fins d’assistance et à des placements extrafamiliaux ». Les mesures étaient imposées au nom de l’assistance, mais en réalité, elles causaient souvent d’immenses souffrances. Quelle est l’origine de ces mesures? Quelles idéologies sociopolitiques les ont influencées ? Et comment la pratique a-t-elle évolué au fil du temps?
Le terme « mesures de coercition à des fins d’assistance et placements extrafamiliaux » est un terme générique. Il désigne différentes mesures qui ont été mises en œuvre du XIXe siècle jusqu’aux années 1970, parfois même plus longtemps. L’objectif était de lutter contre la pauvreté et de faire régner l’ordre social. Ces mesures ont visé des enfants, des adolescents et des adultes. Ces personnes ont été victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles extrêmes, ont souffert de la faim, ont été négligés sur le plan sanitaire ou ont été exploités à des fins économiques.
Parmi les mesures les plus courantes figuraient le placement des enfants et des adolescents dans des foyers, des « établissements d’éducation » ou des familles d’accueil. Certains d’entre eux devaient travailler très dur dans des fermes ou d’autres exploitations en tant qu’« enfants placés ». Cela permettait de réduire les coûts du placement. Des adoptions forcées ont également été ordonnées : des enfants ont été séparés définitivement de leur famille contre la volonté de leur mère ou après que l’on ait fait pression sur celle-ci pour qu’elle accepte une adoption. Le placement forcé d’adultes dans des « hospices de pauvres », des « établissements d’éducation au travail » ou des cliniques psychiatriques constituait également une forme courante de mesures de coercition à des fins d’assistance. Ces placements d’adultes et de mineurs dans des établissements fermés étaient qualifiés d’« internement administratif » : une mesure prise par les autorités, généralement sans décision judiciaire, qui constituait une grave atteinte à la liberté individuelle. Les avortements forcés, les stérilisations forcées et les traitements médicaux ou psychiatriques forcés faisaient également partie des interventions pratiquées dans le cadre de ces mesures.
En tant que minorités persécutées, les Yéniches et les Sintis ont eux aussi été fortement touchés par les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux. Les enlèvements systématiques d’enfants, la dissolution durable des liens familiaux et, par conséquent, la destruction du mode de vie des Yéniches sont aujourd’hui considérés comme des « crimes contre l’humanité ».
Les placements d’enfant n’étaient pas toujours prescrits par une autorité. De nombreux parents dans le besoin se voyaient contraints de placer leurs enfants dans un foyer ou de les envoyer travailler. Ils subissaient aussi parfois des pressions de la part de personnes d’autorité de leur entourage proche (comme le curé ou le pasteur) pour accepter un placement. Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, la pauvreté était très répandue en Suisse, et clairement visible.

Jeunes femmes travaillant dans les champs à la maison d'éducation de Loveresse
Maison d'éducation pour jeunes filles abandonnées à Loveresse (BE). Tiré des albums photos de la Direction de l'aide publique du canton de Berne, exposé à l'Exposition nationale de 1914 à Berne. (Auteur inconnu). Archives d'État du canton de Berne, StABE T.1091, volume 2, numéro d'image 79.
Image: inconnu. Source: Staatliche Erziehungsanstalten: Maison d'éducation pour jeunes filles abandonnées à Loveresse. Zitierung: Staatsarchiv des Kantons Bern, StABE T.1091, Band 2, Bildnummer 79.
Des racines dans la législation cantonale sur les pauvres du XIXe siècle
Les mesures de coercition à des fins d’assistance trouvent leur origine dans la législation cantonale sur les pauvres du XIXe siècle. Elles correspondaient à l’idée que l’on se faisait à l’époque de la lutte contre la pauvreté. La loi sur les pauvres du canton des Grisons de 1857 stipulait par exemple que les enfants pouvaient être retirés à leurs parents si une famille bénéficiait d’une assistance (aujourd’hui aide sociale) et que les enfants n’étaient pas, du point de vue des autorités, élevés et pris en charge de manière adéquate. La loi sur les pauvres du canton de Berne de 1884 en est un autre exemple. Elle prévoyait que les adultes pouvaient être placés dans un « établissement d’éducation au travail » s’ils étaient jugés « débauchés », « fainéants » ou « alcooliques », selon le langage moralisateur et discriminatoire utilisé à l’époque. Ces établissements avaient pour objectif d’inculquer de force la « volonté de travailler » aux personnes qui y étaient internées.
Il n’était pas rare de subir plusieurs mesures de coercition à des fins d’assistance au cours de sa vie. La pratique était marquée par l’imprévisibilité et l’arbitraire ; les personnes concernées ne savaient souvent pas quand pouvait survenir une intervention des autorités. De nombreuses familles ont ainsi été détruites à jamais par la séparation de leurs membres.

Davantage d’interventions possibles avec le Code civil suisse
À partir de 1912, le Code civil suisse (CC) a fourni la base juridique centrale pour les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux. Il permettait aux autorités de retirer la garde des enfants à leurs parents, de les placer chez des tiers, de mettre les adultes sous tutelle ou de les enfermer dans des « établissements ». Au fil du temps, ces mesures ont également été prises à titre préventif. Par exemple, lorsqu’une famille ne percevait pas encore d’aide financière, mais que les autorités craignaient que cela puisse être le cas à l’avenir. Comme de nombreuses lois cantonales étaient toujours en vigueur, la situation juridique était confuse.
Les autorités qui prenaient les décisions étaient souvent composées de profanes qui n’étaient pas spécifiquement formés pour accomplir cette tâche exigeante. Elles disposaient toutefois d’une grande marge de manœuvre dans leurs décisions et leurs actions, et donc d’un pouvoir considérable. Presque personne ne vérifiait leurs décisions. Elles jugeaient généralement les gens et leur comportement selon des critères moraux. Elles pouvaient par exemple accuser quelqu’un d’être « trop paresseux » pour tenir correctement son ménage. Ce faisant, elles négligeaient le fait que certains parents n’avaient que peu de revenus et manquaient de temps pour s’occuper de leurs enfants, et que les loyers élevés contraignaient de nombreuses familles à vivre dans des logements exigus, insalubres et délabrés.
Modèle familial patriarcal bourgeois
Le Code civil suisse avait été adopté par un parlement qui représentait majoritairement un modèle familial patriarcal et bourgeois. C’est donc ce modèle que les parlementaires ont inscrit dans la loi. Le père devait subvenir aux besoins de la famille et la mère s’occuper du ménage et des enfants. La pratique des mesures de coercition à des fins d’assistance était aussi influencée par ce modèle : si le père de famille ne gagnait pas suffisamment d’argent, il risquait d’être envoyé dans un « établissement fermé d’éducation par le travail ». Les femmes étaient généralement jugées selon des critères dits « moraux ». Être mère célibataire, par exemple, était très mal vu par une grande partie de la société. On les considérait, elles et leurs enfants, comme inférieurs. À cela s’ajoutait le fait que les mères célibataires n’avaient généralement pas les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, et qu’il n’existait pas suffisamment d’offres de garde. Ainsi, les enfants nés hors mariage étaient souvent placés dans des familles nourricières. Les enfants de parents divorcés aussi couraient un risque élevé d’être séparés de leurs parents. En effet, le divorce était considéré comme un échec personnel et moral. Les autorités jugeaient donc souvent nécessaire de placer les enfants qu’elles qualifiaient d’« orphelins par divorce » dans un foyer ou une famille d’accueil.


Attitude autoritaire et hiérarchies sociales
Les autorités agissaient de manière très autoritaire. Les adultes étaient rarement interrogés sur leurs besoins ; les enfants et les adolescents ne l’étaient pratiquement jamais. Les approches modernes du travail social, fondées sur une conception plus égalitaire de l’assistance, ne se sont imposées que progressivement au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les personnes concernées n’avaient pratiquement aucun recours juridique pour s’opposer à une mesure de coercition à des fins d’assistance ou à un placement extrafamilial. Il était certes possible de faire recours devant un tribunal dans certains cantons, mais les recherches ont montré que ces procédures étaient peu fréquentes et rarement couronnées de succès. Cela s’explique par plusieurs raisons : les personnes concernées ne savaient par exemple pas quelles possibilités de recours elles avaient. En règle générale, elles n’avaient pas non plus les moyens financiers de faire appel à un avocat. Les mesures de coercition à des fins d’assistance contribuaient ainsi à entretenir les inégalités au sein de la société. Au lieu de soutenir les personnes concernées, on aggravait leur marginalisation et leur stigmatisation. Les hiérarchies sociales restaient en place.
Qui est responsable ?
De nombreuses personnes, autorités et institutions ont été impliquées dans la pratique des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux. Il y avait celles qui édictaient les lois et celles qui prenaient les décisions. Ces dernières étaient souvent des autorités locales, par exemple des autorités tutélaires. Des institutions telles que les foyers, les « établissements d’éducation », les cliniques psychiatriques ou les nombreuses associations dites « de protection de l’enfance » (par exemple l’« Œuvre des enfants de la grand-route » ou la « Seraphisches Liebeswerk ») faisaient également partie du dispositif. De plus, jusque tard dans la seconde moitié du XXe siècle, les exigences légales relatives au contrôle et à la surveillance des structures d’accueil étaient négligées par bon nombre d’autorités. Par ailleurs, selon le droit pénal, le personnel de l’établissement ou les parents devaient être punis en cas de violence ou d’abus graves. Mais il était rare que des procédures pénales aboutissent. Et même celles-ci ne garantissaient pas que justice soit rendue aux victimes. La justice pouvait prendre des décisions unilatérales et défavorables aux personnes concernées. Souvent, des liens personnels étroits entre les différents acteurs des autorités empêchaient toute perspective indépendante. Les Églises aussi jouaient un rôle central dans ce dispositif. Elles géraient des établissements et fournissaient du personnel aux foyers ou aux « institutions ». Elles faisaient autorité en matière de morale et soutenaient les pratiques de coercition à des fins d’assistance. La recherche montre, par ailleurs, que des principes moraux rigides et les structures ecclésiastiques favorisaient les abus et leur dissimulation. La population dans son ensemble, qui est restée silencieuse ou indifférente pendant longtemps, a également sa part de responsabilité.

Recul des mesures de coercition à des fins d’assistance après la Seconde Guerre mondiale
La première moitié du XXe siècle a été marquée par les attitudes conservatrices et autoritaires, les crises économiques et la pauvreté. Les protections légales en cas de maladie, d’accident ou de chômage étaient pratiquement inexistantes. Cette situation a conduit à un nombre particulièrement élevé de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux pendant cette période.
Ce nombre a diminué de manière constante durant la seconde moitié du XXe siècle, ce qu’expliquent l’essor économique sans précédent qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, l’introduction de nouvelles assurances sociales (telles que l’assurance vieillesse et survivants/AVS en 1948) et le développement des services ambulatoires d’aide et de conseil. La main-d’œuvre étrangère a joué un rôle déterminant dans l’essor économique. Alors que les conditions de vie de nombreux Suisses et de nombreuses Suissesses s’amélioraient progressivement, la politique familiale répressive touchait désormais de plus en plus les personnes migrantes : beaucoup de familles ont été déchirées parce que les enfants n’étaient pas autorisés à entrer en Suisse, devaient vivre cachés ou dans des foyers.
Il est aujourd’hui impossible de savoir combien de personnes au total ont été concernées par des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux en Suisse. D’après les recherches, on estime leur nombre à plusieurs centaines de milliers.

Les années 1970 : évolution des valeurs et extension des droits fondamentaux
Les années 1970 ont marqué une période de nombreux bouleversements dans la pratique des mesures de coercition à des fins d’assistance. À cette époque, de nouveaux mouvements sociaux ont remis en question les autorités traditionnelles et les rapports de force dans différents domaines de la société. Les normes patriarcales ont été critiquées ; les femmes ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité en 1971. Les gens aspiraient à des modes de vie moins conventionnels et souhaitaient vivre plus librement. Dans le sillage de ces bouleversements sociaux, des groupes critiquant le fonctionnement des établissements fermés, comme la « Heimkampagne » ou l’« Aktion Strafvollzug » (ASTRA) ont vu le jour. Ils dénonçaient des structures obsolètes, des pratiques pénales dégradantes et le travail forcé dans les « établissements d’éducation », les prisons et les hôpitaux psychiatriques. Des associations défendant les droits des personnes handicapées se sont également mobilisées.
L’adhésion de la Suisse à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en 1974 a marqué un tournant important dans cette évolution. La CEDH interdit d’emprisonner des personnes pour des motifs vagues tels que le risque d’avoir besoin d’assistance. Elle stipule en outre que toute personne privée de liberté doit être informée sans délai des motifs de cette privation et avoir la possibilité de faire contrôler la décision par un tribunal indépendant. Pour se conformer à ces prescriptions, la Suisse a introduit en 1981 dans le CC (et donc au niveau fédéral) des règles uniformes relatives à la privation de liberté à des fins d’assistance (rebaptisée « placement à des fins d’assistance » en 2013) dans des établissements spécialisés.
Les droits de l’enfant aussi ont été modernisés dans le CC dans les années 1970. À partir de 1978, par exemple, les mères célibataires ont obtenu la garde de leurs enfants. Il a toutefois fallu attendre encore plusieurs années avant que le droit de la tutelle du CC soit révisé.

Femme sur une échelle en train de recouvrir une affiche électorale des opposants au droit de vote des femmes, 1969
La photographie a probablement été prise dans le cadre de la « Marche sur Berne ».
Image: inconnu. Source: F Fc-0003-39, Schweizerisches Sozialarchiv.

Manifestantes et manifestants brandissant des banderoles contre le système pénitentiaire
Manifestation du 1er mai 1976 à Berne, Marktgasse.
Image: Hansueli Trachsel. Source: @ Flavia Fall, fotoCH, ID photo : 150514.

Transparent « Contre la psychiatrie meurtrière », 1980
Une personne à l'AJZ (centre autonome pour la jeunesse de Zurich) peint une banderole avec le slogan « Contre la psychiatrie meurtrière », 12 juillet 1980.
Image: Gertrud Vogler. Source: F 5107-Na-10-058-012, "Jugendbewegung, 12.07.1980" - Transparent "Gegen die tötende Psychiatrie"; AJZ, Zürich, Schweizerisches Sozialarchiv.
Le cheminement vers le présent
Les dispositions qui ont remplacé le droit de la tutelle en place depuis 1912 sont entrées en vigueur en 2013 sous le nom de « droit de la protection de l’enfant et de l’adulte ». Un changement central a été apporté : dès lors, dans tous les cantons ce sont des comités composés de spécialistes issus de différents domaines qui doivent décider des mesures à prendre, et ce ne sont plus des autorités non spécialisées.
La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée en 1989, a été une autre étape importante dans le renforcement des droits de l’enfant. La Suisse y a adhéré en 1997. Elle exige que les enfants soient protégés contre les abus et l’exploitation et qu’ils soient pris au sérieux en tant que personnes à part entière.
L’histoire des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux montre que, pendant longtemps, la restriction massive des droits individuels de certaines personnes a été considérée comme allant de soi. On exerçait sur elles une influence incapacitante et directive afin de lutter contre la pauvreté et d’imposer un ordre social. Aujourd’hui encore, le travail social est marqué par une tension fondamentale entre aide et contrôle. Il reste essentiel de continuer à examiner attentivement cette question et d’y réfléchir de manière approfondie. Il est également important de se demander quelles leçons peuvent être tirées des atteintes à la personnalité passées pour l’approche actuelle des droits fondamentaux et des droits de la personne.