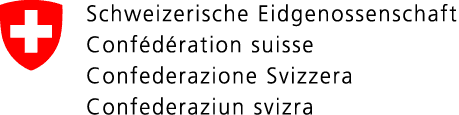Critiques et opposition
Les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux ont régulièrement été critiqués publiquement par le passé. Pendant longtemps, cependant, les protestations n’ont eu que peu d’impact sur leur développement. Ce n’est qu’au tournant des années 1970, lorsque les médias ont commencé à critiquer les foyers, les lois et les internements administratifs à grande échelle, qu’un débat public s’est engagé. Les dénonciations des personnes concernées elles-mêmes n’ont longtemps pas suffit à améliorer leur situation. La prise en compte de leur voix était une condition préalable importante pour le travail de mémoire.
Abus dans les institutions et absence de droits de la défense
L’un des premiers et des plus importants contradicteurs du système de placement et d’internement de l’époque a été l’écrivain Carl Albert Loosli (1877-1959). Il avait lui-même grandi dans des foyers. Dans son ouvrage « Anstaltsleben », publié en 1924, il réclamait déjà la suppression des institutions. Dans les années 1930, Loosli a également dénoncé dans d’autres publications la « justice administrative » qu’il jugeait contraire aux droits humains. Avec ses critiques, Loosli provoquait les élites. Néanmoins, à partir des années 1940, l’opinion selon laquelle le droit administratif qui encadraient les mesures coercitives devait être réformé s’est imposée, y compris dans les cercles juridiques. Les critiques portaient notamment sur le fait que les personnes ciblées étaient privées de possibilité de défense et de voies de recours.
D’autres personnes aussi ont critiqué publiquement les dysfonctionnements dans les institutions dès les années 1930. Des journaux ont publié des articles sur la violence, l’exploitation, les abus sexuels et même sur la mort tragique d’un enfant placé. Les mauvais traitements infligés aux enfants et aux adolescents sont également devenus visibles grâce à des reportages publiés dans les magazines illustrés. Les photographies les plus connues sont sans doute celles de Paul Senn (1901-1953), qui a documenté dans ses reportages la vie de la population rurale et de personnes qui n’étaient pas habituellement sous les feux de la rampe. Celles-ci ont également été utilisées pour mettre en évidence et problématiser la précarité des conditions de vie des familles. Des photographes suisses de renom ont cependant aussi réalisé des reportages photos sur les enfants yéniches et leurs familles pour le compte de Pro Juventute. Dans ce cas les mises en scènes pour la plupart dénigrantes, devaient convaincre la population de la nécessité de retirer les enfants à leurs parents.
Réformes lentes et protestations publiques
Certaines voix ont continué à qualifier les dysfonctionnements structurels du placement d’enfants comme des cas particuliers tragiques et des fautes commises par des individus isolés. Mais, les points de vue critiques de spécialistes étaient aussi de plus en plus pris en compte, comme celui de la pédopsychiatre Marie Meierhofer (1909-1998). Ses recherches menées dans des pouponnières dans les années 1950 et 1960 lui avaient montré que les nourrissons placés dans ces établissements développaient de graves symptômes de négligence.
Les critiques du placement d’enfants et de l’exécution des mesures ont finalement conduit à des réformes juridiques et institutionnelles. Afin de lutter contre ces dysfonctionnements, des associations telles que l’action suisse pour les enfants placés (« Pflegekinder-Aktion ») ont été créées dès les années 1950. Les changements ont cependant été très lents et progressifs. Les milieux professionnels réclamaient notamment davantage de formation, une meilleure rémunération du personnel, ainsi que de moyens financiers plus conséquents pour les établissements.
Il a fallu attendre les mouvements sociaux de 1968, l’avènement des médias de masse et l’influence des débats transnationaux pour que les autorités et autres responsables soient remis en cause. Dans différents magazines, les « maisons d’éducation » ont été attaquées et ont fait les gros titres. En Suisse, comme en Allemagne auparavant, un mouvement social a vu le jour au début des années 1970. La « Heimkampagne » (« campagne pour les foyers ») a tenté d’améliorer les conditions des jeunes placés en foyer et institutions en organisant des manifestations publiques et des actions de libération parfois spectaculaires. La situation n’a toutefois évolué que très lentement pour les jeunes, même si eux aussi résistaient.

Marie Meierhofer à l'institut de recherche sur l'enfance qui porte son nom (Marie Meierhofer Institut für das Kind MMI) à l'occasion de son 75e anniversaire en 1984.
Pour les personnes concernées, résister comportait des risques importants
Il y a toujours eu des actions de rébellion verbale, des tentatives d’évasion ou des grèves de la faim de la part des personnes placées ou internées. Certaines ont aussi écrit des lettres, déposé des plaintes et chargé des avocats de faire des recours. Mais leurs arguments n’ont que peu été entendus, voire interprétés comme des actes de désobéissance devant être réprimés. Lorsqu’elles se défendaient, elles devaient souvent s’attendre à des sanctions. Dans le cas d’amélioration, celle-ci était souvent moindre et précaire. C’est ce que mettent en évidence les témoignages actuels et les dossiers personnels conservés dans les archives.
La protection juridique a longtemps été insuffisante en Suisse. En règle générale, les instances de recours statuaient uniquement sur la base des dossiers et des avis des autorités. Elles ne faisaient pas leurs propres recherches et confirmaient simplement les décisions de l’instance précédente. Il y avait également un manque de solidarité envers les personnes défavorisées. Les personnes concernées avaient souvent peu de ressources. Elles n’étaient pas informées de leurs droits de recours et n’avaient pas les moyens financiers de se faire assister par un avocat.
Interventions infructueuses
Le socialiste grison Gaudenz Canova (1887-1962), avocat et homme politique s’est par exemple engagé à plusieurs reprises en faveur des personnes concernées. Il exigeait que les droits humains soient respectés. Il critiquait sévèrement les psychiatres, dont les expertises qualifiaient arbitrairement les patients de « malades mentaux » et « nécessitant un internement permanent ». Ses interventions échouaient cependant souvent, car les professionnels de la santé jouissaient d’un grand pouvoir d’interprétation. Il en allait de même pour des personnes moins connues du public, qui s’engageaient elles aussi souvent bénévolement pour les personnes concernées. Parmi elles, figuraient notamment des assistantes sociales, des pasteurs, des curés et des juristes, qui devaient faire face à des calomnies et à des attaques personnelles.
Un long combat pour réparer les injustices

Il a fallu du temps pour que les personnes concernées soient entendues, mais aussi pour que l’on prenne leurs récits au sérieux. De plus en plus d’entre elles ont désigné l’État comme responsable des injustices et des souffrances qu’elles avaient subies. L’une des premières a été l’écrivaine, journaliste et activiste politique yéniche Mariella Mehr (1947-2022). Dans ses livres, elle ne faisait pas qu’exposer ouvertement les violences qu’elle avait subies : elle exigeait également des responsables qu’ils reconnaissent officiellement les Yéniches en tant que minorité en Suisse et le tort qui leur avait été fait. À partir des années 1980, la Confédération a commencé à se mobiliser pour réparer les injustices commises à l’encontre des Yéniches et des Sintis et pour garantir des protections aux minorités.
Depuis les années 1990, de plus en plus de personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux se sont manifestées publiquement. Elles ont élevé la voix au nom des nombreux individus qui avaient subi des souffrances inimaginables à cause de l’intervention des autorités dans leur vie. C’est grâce à l’engagement sans faille des personnes concernées et à leur regroupement en collectifs que l’opinion publique et les décideurs politiques ont pris conscience de l’injustice et la souffrance subies. L’engagement personnel des personnes concernées était souvent éprouvant et s’accompagnait parfois d’une stigmatisation et d’une exclusion supplémentaires. Leurs témoignages et récits montrent toutefois très clairement qu’il ne s’agissait pas simplement de cas isolés, et ont finalement permis un travail de mémoire approfondi à l’échelle nationale.