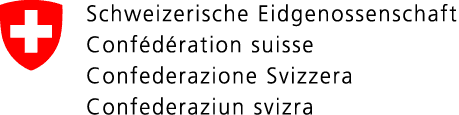Étude scientifique
La recherche est un pilier central du travail de mémoire et une revendication importante des personnes concernées. Elle montre pourquoi les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux ont existé, qui les a ordonnés et comment ils ont été mis en œuvre. L’étude scientifique permet de mieux comprendre les injustices subies et leurs conséquences.

Regard critique sur les mesures de coercition à des fins d’assistance
Des travaux scientifiques sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux ont été publiés dès le début du XXe siècle. Cependant, ceux-ci considéraient généralement les personnes concernées comme de simples objets et servaient souvent à justifier les mesures de contrainte appliquées. Ce n’est que depuis les années 1980 que des études scientifiques examinent ces mesures de manière critique. Aujourd’hui, différentes disciplines s’y intéressent : l’histoire, les sciences sociales, le travail social, la psychologie ou encore le droit. Les perspectives et les expériences des personnes concernées y sont reconnues comme une expertise importante et sont prises en compte dans la recherche. Les approches participatives gagnent en importance. Les personnes concernées participent activement au processus de recherche et contribuent, par exemple, à l’élaboration des questions.
Différents domaines de recherche
La recherche sur les mesures de coercition à des fins d’assistance se concentre souvent sur certains groupes de personnes concernées. Ainsi, on a très tôt étudié comment l’« Œuvre des enfants de la grand-route » de la fondation Pro Juventute était intervenue dans la vie des familles yéniches. Les études sur l’eugénisme et la contrainte en psychiatrie et dans le domaine de la tutelle constituaient un domaine de recherche à part entière. Plus tard, l’attention s’est portée sur des thèmes tels que le placement d’enfants, l’éducation en foyer ou l’internement administratif d’adultes dans des « établissements d’éducation au travail ». Aujourd’hui, d’autres domaines sont étudiés, notamment les placements dans des « hospices de pauvres », les adoptions forcées en Suisse et à l’étranger ou les conséquences du statut de saisonnier pour les familles et leurs enfants.

Des bébés sur la terrasse du foyer Alpenblick à Hergiswil.
Le personnel était peu nombreux et devait s'occuper d'un grand nombre de jeunes enfants. À partir des années 1960, les infirmières et les élèves infirmières ont tenté de mettre en pratique les conclusions des recherches menées par l'« Institut für Psychohygiene im Kindesalter » (Institut pour l'hygiène mentale chez l'enfant), fondé en 1957 par la pédopsychiatre et chercheuse Marie Meierhofer, afin d'améliorer les conditions d'accueil.
Image: privé

Mère yéniche avec son enfant
L'intervention de l'État dans les familles yéniches par le biais de « Les Enfants de la grand-route » de la fondation Pro Juventute a été massive. Ces interventions ont fait l'objet de recherches dès le début.
Image: Hans Staub. Source: 1978.999.559, © Hans Staub / Fotostiftung Schweiz.

Vues intérieures de la clinique psychiatrique Waldau ou Münsigen en 1948
La photo a probablement été prise en 1948 par Walter Nydegger pour le Conseil-exécutif bernois. La recherche sur l'histoire de la psychiatrie constitue un domaine important dans le cadre du travail de mémoire sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements d'enfants.
Image: Walter Nydegger. Source: Innenansichten der Psychiatrischen Kliniken Waldau und Münsigen für den Regierungsrat, 1948, Staatsarchiv des Kantons Bern, StABE FN Nydegger 1096, Nr. 11.

Plantation de pommes de terre à Entlebuch, Romoos, 1941
Les enfants placés et les enfants en foyer devaient souvent effectuer des travaux pénibles et étaient fréquemment victimes de violence, d'exploitation et de négligence. La recherche interdisciplinaire sur l'histoire de ces enfants est très vaste.
Image: Theo Frey. Source: 2007.55.037, © Theo Frey / Fotostiftung Schweiz.
Depuis 2010 environ, des études régionales portant sur différents cantons et communes sont venues compléter ces données. Plusieurs institutions ont elles aussi commencé à mener une réflexion scientifique sur leur propre passé. Au niveau national, le Programme national de recherche PNR 51 Intégration et exclusion s’est penché entre 2003 et 2007 sur les processus d’exclusion sociale qui jouaient également un rôle dans les mesures de coercition à des fins d’assistance. Plus tard, entre 2014 et 2019, la Commission indépendante d’experts (CIE) a enquêté sur les internements administratifs, c’est-à-dire des privations de liberté décidées par des instances administratives sans référence au droit pénal et exécutées dans des « établissements fermés d’éducation au travail » et autres « institutions ». Le Programme national de recherche PNR 76 Assistance et coercition (2017-2024) a pris le relais en se penchant notamment sur les placements extrafamiliaux ainsi que sur les conséquences à long terme des mesures de coercition à des fins d’assistance et sur le recours actuel à la contrainte dans le domaine social. Les Églises nationales aussi ont commencé à se pencher sur leur implication dans les mesures de coercition à des fins d’assistance.
Importance de l’étude scientifique
Les recherches menées sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux montrent à quel point ces mesures ont fait partie intégrante de la politique sociale suisse jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. On estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de personnes concernées aux XIXe et XXe siècles.
Les études scientifiques sont un élément central du travail de mémoire de la société. Elles fournissent les bases empiriques nécessaires à la reconnaissance politique et contribuent à faire évoluer la mémoire collective et à instaurer un patrimoine de la mémoire qui inclut tout le monde. De plus, elles remettent en question les visions traditionnelles de l’histoire et permettent de relativiser l’idée d’une Suisse progressiste et démocratique. Enfin, la recherche soulève sans cesse de nouvelles questions. Elle apporte un éclairage différent sur certains thèmes et ses réponses incitent à une réflexion critique sur l’État de droit ainsi que sur la pratique actuelle dans le domaine social et dans celui de la protection de l’enfant et de l’adulte.