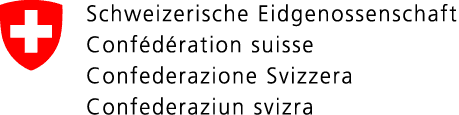Travail de mémoire de l’État
En Suisse, le travail de mémoire sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux a commencé dans les années 1990. En 1986, pour la première fois, un conseiller fédéral a présenté des excuses pour les retraits systématiques d’enfants à des familles yéniches. Par la suite, plusieurs initiatives politiques ont été menées au Parlement fédéral à propos de différentes mesures coercitives. En 2010, une conseillère fédérale a présenté des excuses aux personnes ayant subi un placement administratif. Une cérémonie de commémoration nationale a finalement eu lieu à Berne en 2013 et une table ronde a été mise en place afin de planifier un travail de mémoire approfondi. Depuis 2017, la Suisse dispose d’une base légale pour mettre en œuvre ce travail de mémoire.

Retraits d’enfants de familles yéniches
Les critiques envers les mesures de coercition à des fins d’assistance existaient déjà au début du XXe siècle. Mais ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale, avec l’essor économique, le développement de l’État social et les changements sociaux que les pratiques ont progressivement changé et que des bases légales ont été adaptées.
Les médias ont parlé pour la première fois de la séparation systématique des familles yéniches au début des années 1970. Ce reportage, dans lequel des personnes de la communautés yéniche mettaient en cause l’État a permis d’ouvrir un débat public et a entraîné la dissolution de l’« Œuvre des enfants de la Grand-route » en 1973. Après une longue lutte parfois acharnée, les Yéniches ont finalement réussi à se faire entendre au Parlement. En 1986, le président de la Confédération de l’époque, Alphons Egli, s’est excusé pour le cofinancement par la Confédération de l’« Œuvre » de la fondation Pro Juventute, qui avait causé de grandes souffrances. Pro Juventute a également présenté ses excuses en 1987. En 1988, une commission pour les dossiers et les fonds d’archives a été mise en place dans le but de permettre aux personnes yéniches concernées de consulter leurs dossiers. Jusqu’en 1992, des indemnités financières d’un montant maximal de 20 000 francs étaient également versées aux victimes. Les dossiers sont depuis conservés aux Archives fédérales.
Lutte pour la reconnaissance des injustices et des souffrances subies
D’autres personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux ont continué à lutter pour la reconnaissance de l’injustice et de la souffrance qu’elles avaient subies. Certaines ont exposé leurs histoires de vie bouleversantes et se sont battues pour obtenir reconnaissance et réparation. Le regroupement de personnes concernées en collectifs et la sensibilisation croissante de la société aux droits des victimes ont finalement permis un revirement. À l’instigation des personnes concernées, des responsables politiques ont lancé des initiatives dans les parlements, qui avec le soutien de personnes issues du monde de la culture, de la recherche et des médias ont créé un débat public. Plusieurs études scientifiques déjà publiées confirmaient ce que les personnes concernées rapportaient : il ne s’agissait pas de quelques destins tragiques isolés, mais d’atteintes graves à la vie de centaines de milliers de personnes dans toute la Suisse.
L’État prend ses responsabilités
La Suisse n’est pas le seul pays à se confronter à ce chapitre sombre de son histoire. Cependant, le processus politique de traitement de cette question a buté sur les responsabilités partagées des instances cantonales et communales en matière de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux. La Confédération a finalement pris ses responsabilités et engagé en collaboration avec les cantons la mise en place d’un processus national de réhabilitation et de reconnaissance des injustices subies dans toutes les régions du pays. Ce travail de mémoire a été rendu possible grâce à la persévérance des personnes concernées, qui ont rendu leurs histoires publiques et se sont battues pour cela pendant des décennies.
En 2010, lors d’une cérémonie commémorative à la prison pour femmes de Hindelbank, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a présenté des excuses en compagnie de représentants des cantons. Les excuses s’adressaient à toutes les personnes qui avaient été internées dans des établissements par les autorités sans condamnation pénale. Cela s’est produit 30 ans après que les dispositions cantonales sur l’internement administratif aient été remplacées par les nouvelles dispositions sur la privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) dans le CC.
Une cérémonie commémorative nationale a eu lieu à Berne en avril 2013. La conseillère fédérale de l’époque, Simonetta Sommaruga, ainsi que des représentants des cantons, des églises nationales et d’associations, ont présenté leurs excuses devant quelque 700 personnes concernées pour l’injustice et la souffrance qui leur avaient été infligées. Parmi elles, il y avait des personnes qui, enfants, avaient été exploitées comme main-d’œuvre dans des fermes ou maltraitées dans des foyers et des institutions, qui avaient subi des mesures de contrainte en hôpital psychiatrique ou qui avaient été forcées de donner leur enfant à l’adoption. Cette cérémonie commémorative a marqué le début d’un vaste travail de mémoire national. La conseillère fédérale a mis en place une table ronde pour toutes les victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux. Les cantons ont chargé les centres d’aide aux victimes de conseiller les personnes concernées et les archives de l’État ont accompagné les recherches de dossiers.
En septembre 2013, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative, qui est entrée en vigueur le 1er août 2014. Elle reconnaissait l’injustice, posait les bases pour scientifique de mémoire sur les internements administratifs, réglementait l’archivage et l’accès aux dossiers, mais excluait clairement toute prestation financière pour les victimes. Mais cela ne s’est pas arrêté là, d’autres mesures sont venues s’ajouter.
Base légale pour un travail de mémoire approfondi
La table ronde déjà mentionnée avait pour mission de préparer un travail de mémoire approfondi, de mettre en place des mesures et d’en assurer le suivi. Y ont pris part tant des personnes concernées et des représentants de collectifs de personnes concernées, que des représentants d’autorités, d’institutions et d’organisations professionnelles. Un fonds d’aide d’urgence a été créé pour les personnes concernées en situation de détresse. Le rapport de la table ronde, comportant des recommandations sur le travail de mémoire historique, juridique et sociopolitique ainsi que sur les prestations financières, a constitué une base importante pour l’élaboration du futur projet de loi.
L’« initiative sur la réparation », lancée en 2014 par Guido Fluri et un large comité de soutien, a contribué à ce que les paroles soient suivies d’actes. Elle demandait une reconnaissance officielle de l’injustice infligée aux victimes, le versement d’une contribution de solidarité, une étude scientifique ainsi que l’information et la sensibilisation du grand-public. Le Parlement a finalement adopté le contre-projet proposé par le Conseil fédéral, qui prenait en compte les principales revendications de l’initiative et réglementait, en outre, l’archivage et la consultation des dossiers. Il ancrait ainsi dans la loi le conseil et le soutien aux personnes concernées et aux victimes. L’adoption du contre-projet du Conseil fédéral a permis de mettre en œuvre beaucoup plus rapidement les différentes mesures liées au travail de mémoire.

Ainsi, le 1er avril 2017, la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) est entrée en vigueur. Elle a remplacé la loi fédérale de 2014 mentionnée plus haut sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative. Sur la base de la LMCFA, les victimes peuvent demander une contribution de solidarité de 25 000 francs. Au sens de la loi, les victimes sont des personnes dont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ou dont le développement intellectuel a été directement et gravement compromis par des mesures de coercition à des fins d’assistance et par des placements extrafamiliaux. La loi réglemente en outre la consultation des dossiers par les personnes concernées, l’étude scientifique et sa transmission au grand public, et encourage la création de « symboles commémoratifs » par les cantons.
Sensibilisation du public aux injustices commises
Sous l’impulsion de la loi fédérale, les cantons et les communes, ainsi que certaines organisations et fondations, ont eux aussi participé au travail de mémoire. En guise de « symboles commémoratifs », ils ont créé des monuments, participé à des expositions, commandé des études scientifiques et sensibilisé l’opinion publique aux injustices commises. Depuis 2023, la ville de Zurich verse une contribution de solidarité supplémentaire si des autorités municipales ou des foyers ont été impliqués. D’autres communes, et même des cantons, comme Schaffhouse et Zurich, veulent suivre cet exemple.
En février 2025, le Conseil fédéral a reconnu, sur la base d’une expertise juridique, que la répression systématique des Yéniches constituait un « crime contre l’humanité » au sens du droit international public actuel. Les retraits d’enfants de familles yéniches pour des motifs racistes constituent, du point de vue actuel, une violation particulièrement grave des droits humains. La Confédération réfléchit actuellement avec les Yéniches et les Sinti aux prochaines étapes.

Le travail de mémoire sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux se poursuit à tous les niveaux étatiques. Des organisations et des institutions privées, sociales et religieuses ont également commencé à se pencher sur leur histoire et à échanger avec les personnes concernées.