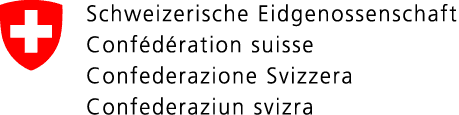Conséquences pour les personnes concernées
Les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux ont très souvent eu de lourdes conséquences pour les personnes concernées, affectant durablement leur vie et ayant également des répercussions sur leur descendance. À ce jour, nombre d’entre elles ont encore des problèmes de santé, des difficultés financières ou souffrent d’exclusion sociale. Elles craignent de subir de nouvelles restrictions, voire de perdre leur autonomie, par exemple si elles devaient avoir besoin de soins en vieillissant.
Atteintes graves à la vie des personnes
Au cours de leur vie, les personnes concernées subissaient souvent plusieurs formes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux : enfants, elles étaient retirées à leurs parents, elles grandissaient dans des foyers et des familles d’accueil, étaient généralement placées à plusieurs reprises dans des lieux différents, examinées par des spécialistes, assignées à des classes spécialisées et, pour certaines, internées par décision administrative à l’âge adulte. Parfois, les enfants et les adolescents étaient déjà victimes de violence intrafamiliale dans leur famille d’origine. Au lieu d’aider les familles en difficulté, les autorités les détruisaient. Les contacts avec les parents étaient dans bien des cas interdits et les fratries étaient séparées.

Beaucoup de ces personnes ont connu de grandes souffrances. Elles n’ont pas pu grandir dans leur famille d’origine, ont été exploitées et ont connu la négligence et de graves formes de violence dans les foyers, les familles d’accueil et les familles adoptives : on les a battues, humiliées, beaucoup d’entre elles ont aussi subi des violences sexuelles, voire ont été poussées au suicide. La plupart n’ont pas pu suivre une scolarité normale, et encore moins apprendre un métier.
Il y a également eu des cas de médication forcée, de stérilisation imposée et de mariages empêchés.
Le présent du passé
Les récits de nombreuses personnes concernées montrent également à quel point elles ont été seules et isolées, et le sont parfois encore aujourd’hui. Après leur sortie du foyer, leur libération ou la levée de leur tutelle, les difficultés n’étaient pas finies et de nouveaux défis se présentaient. Beaucoup n’avaient plus aucun contact avec leur famille, étaient limitées dans leur activité professionnelle et souffraient de troubles psychiques ou physiques en conséquence des violences subies. À cela s’ajoutaient des préjugés sociaux, un manque de relations sociales et une méconnaissance de la vie quotidienne en dehors des institutions.

De nombreuses personnes concernées racontent qu’elles ont encore aujourd’hui parfois du mal à faire confiance aux autres ou à nouer des relations. Les membres de leur famille étaient pour elles des étrangers, et parfois le sont restés. Dans les dossiers, on trouve souvent des descriptions dégradantes de leur personne ou de leur famille. Mais ces dossiers sont souvent les seuls souvenirs qui restent de leur enfance.
Le passé les rattrapait sans cesse, par exemple lorsqu’elles postulaient à un emploi et devaient présenter leur CV ou lorsque leurs parents étaient absents à un événement marquant de leur vie. Aujourd’hui encore, la stigmatisation est grande et de nombreuses situations sont associées à la honte. La réputation des lieux et les institutions dans lesquels elles ont été placées ou internées (maisons d’éducation, établissements de travail forcé, hôpitaux psychiatriques et prisons) y sont aussi pour quelque chose.

Conséquences pour les générations suivantes
Ce vécu a également des répercussions directes sur les proches, les amitiés et les relations amoureuses. Les faibles revenus, les coûts élevés liés à la santé et l’absence de modèles positifs pèsent également sur la vie future des familles des personnes concernées. Leurs enfants racontent qu’ils percevaient leurs parents comme distants, peu expressifs ou parfois violents. Les personnes concernées de la deuxième génération mentionnent aussi à plusieurs reprises que leurs parents ne peuvent pas leur parler des souffrances et des injustices subies, ou alors depuis peu. Depuis qu’ils ont pu constater et ressentir que de nombreuses autres personnes concernées vivaient des expériences similaires.
Une vie de discrimination
L’étude scientifique vient confirmer le ressenti des personnes concernées : elles sont souvent désavantagées toute leur vie. Certes, la contribution de solidarité de 25 000 francs reconnaît l’injustice commise au sens d’un signe symbolique de solidarité sociale et le versement unique permet à de nombreuses personnes de réaliser pour la première fois de leur vie un rêve ambitieux. Mais une contribution de solidarité n’est pas une indemnité susceptible d’améliorer durablement les conditions de vie. Les contributions de la Confédération ou des cantons ainsi que le soutien apporté par les points de contact cantonaux ne permettent pas de couvrir tous les besoins des personnes concernées. Beaucoup d’entre elles souhaitent bénéficier d’un soutien à plus long terme. C’est justement lorsqu’elles sont âgées, qu’elles ont besoin de soins ou qu’elles doivent intégrer une maison de retraite ou un établissement médico-social, qu’elles peuvent être confrontées à nouveau à des expériences négatives du passé. Le contact avec les autorités, telles que les services de protection de l’enfance et de l’adulte, ou un examen médical peuvent aussi représenter un défi de taille, car leurs expériences passées les poussent à se sentir vulnérables face à ces institutions ou à penser qu’on ne les prend pas au sérieux. D’autres souhaitent recevoir un soutien parce qu’elles ont des relations difficiles avec leurs proches ou des rapports tendus avec leur entourage immédiat. Pour les générations suivantes, il existe encore peu d’offres et de possibilités de travail collectif sur le passé.
Une vie autonome pour objectif
La façon dont les personnes concernées évaluent leur situation actuelle dépend généralement de leur capacité à développer une estime de soi et à mener une vie autonome malgré les souffrances et les injustices subies. Cela exige souvent un énorme engagement de leur part, et elles doivent parfois payer cher pour leur formation ou leurs thérapies. La confrontation avec le passé et les traumatismes subis reste pour beaucoup un sujet de préoccupation tout au long de la vie.

Couverture de l'autobiographie de Louisette Buchard-Molteni (1933-2004), publiée en 1995 sous le titre « Le tour de Suisse en cage, l'enfance volée de Louisette ». Louisette Buchard-Molteni s'est engagée sur les plans politique, militant et artistique contre les mesures coercitives et les placements forcés.