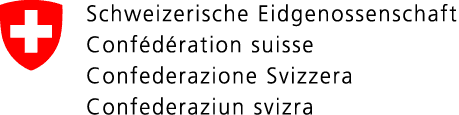Travail de mémoire dans le contexte international
Les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux n’ont pas existé uniquement en Suisse. De nombreux autres pays sont également concernés. Les injustices historiques y sont également étudiées, même si l’accent est mis sur des aspects différents. Il en ressort que les expériences des personnes concernées et les structures de pouvoir qui régissaient les mesures étaient similaires à bien des égards.

Dès les années 1990, des pays comme l’Australie, le Canada ou l’Irlande se sont penchés sur la problématique des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux. En Australie et au Canada, on s’est concentré sur le sort des enfants indigènes arrachés à leur famille pour les forcer à se conformer à la société dominante. En Irlande, ce sont les « couvents de la Madeleine » qui ont focalisé l’attention. La recherche a surtout porté sur les manquements de l’Église catholique, qui y avait joué un rôle central.

Cours à l'école résidentielle catholique romaine pour Indigèns à Denı́nu Kų́ę́ (Fort Resolution), dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada.
L'une des nombreuses « écoles résidentielles » au Canada, dans lesquelles les enfants « autochtones » étaient envoyés afin de les détacher de leur culture d'origine et de les éduquer selon les valeurs chrétiennes européennes.

Blanchisseuses dans un Couvent de la Madeleine en Angleterre au début du XXe siècle.
Les Couvent de la Madeleine, également appelés blanchisseries Magdalene, étaient des établissements dans lesquels des femmes (mères célibataires, travailleuses du sexe, victimes de viols, toxicomanes) étaient détenues contre leur gré et contraintes de travailler. Elles ont souvent dû donner leurs enfants à l'adoption.
Image: inconnu. Source: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11187106.
En Angleterre, en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Autriche, des cas de maltraitance dans des homes d’enfants et d’abus sur des enfants placés dans des familles d’accueil ont eux aussi été mis en lumière par la suite. Ce processus de travail de mémoire a notamment été initié par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989, qui souligne que les enfants ont droit à être protégés et entendus.
Expériences similaires de personnes concernées
Même si l’organisation institutionnelle varie d’un pays et d’une région à l’autre, les formes de violence, les structures du pouvoir et les expériences des personnes concernées sont comparables. D’innombrables personnes ont subi des abus et des violences dans des foyers et des institutions, ont été contraintes au travail et exploitées. Des liens familiaux ont été rompus. Les conséquences de ces violences, telles que le stress post-traumatique ou des problèmes de santé à long terme, continuent de faire souffrir de nombreuses personnes. On constate également dans tous les pays que les personnes concernées sont généralement issues de milieux sociaux et économiques défavorisés. Les mesures prises n’ont généralement pas permis d’améliorer leur situation, et ont souvent au contraire conduit à une baisse du niveau de formation et, à long terme, à leur maintien dans des conditions de vie précaires.
Voies vers le travail de mémoire et la reconnaissance
Les processus de travail de mémoire s’appuient généralement sur plusieurs piliers : des études scientifiques, des contributions financières, un soutien psychologique et les excuses des gouvernements et institutions responsables. Les projets de transmission assurent que les connaissances scientifiques et les témoignages de l’époque soient connus d’un large public. La Suisse a commencé ce processus tardivement par rapport à d’autres pays, mais celui-ci est en revanche très complet. En effet, il ne se limite pas à certaines formes de mesures de contrainte ou à certains groupes de personnes concernées, par exemple les enfants placés dans des familles ou en foyer : il englobe également les internements administratifs, les adoptions forcées, les avortements ou stérilisations forcés et les personnes qui ont été soumises à une médication forcée ou à des tests cliniques.

Les commissions de vérité et de réconciliation ont constitué une autre forme d’approche critique du passé. On en a créé au milieu des années 1990 en Afrique du Sud, après la fin de l’apartheid. Les personnes concernées ont pu raconter leur vécu, les structures de violence ont été mises au jour et des rencontres entre victimes et agresseurs ont eu lieu. Cette démarche devait permettre d’ouvrir la voie à une société démocratique. De nouvelles initiatives apparaissent également pour étudier et reconnaître les injustices. Avec la « Justice Initiative », la Fondation Guido Fluri a lancé une nouvelle initiative politique en collaboration avec des groupes de victimes, des organisations de personnes concernées et des équipes de recherche européennes. Celle-ci s’engage pour un travail de mémoire à l’échelle européenne sur les abus commis sur des enfants et pour une meilleure protection des enfants.
Étant donné que, depuis quelques années, des processus similaires de réévaluation du passé ont lieu dans plusieurs États, on parle d’un « age of inquiry », c’est-à-dire d’une « époque d’enquête ». De nombreux pays s’efforcent de faire évoluer leur culture mémorielle, en portant un regard critique sur le passé. Les personnes qui étaient autrefois systématiquement marginalisées et défavorisées doivent pouvoir s’exprimer et trouver leur place dans la mémoire culturelle commune.