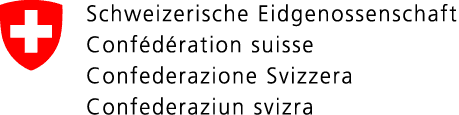Dossiers et accès aux dossiers
Les dossiers sont d’une grande importance pour l’étude des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux. Parallèlement aux entretiens avec les personnes concernées, ils constituent une source d’information centrale permettant d’étudier les pratiques des autorités, des tribunaux et des institutions, parfois aussi celles des personnes concernées qui ne sont plus là pour témoigner. Les personnes concernées aussi ont le droit de consulter leurs dossiers. Pour le dépôt d’une demande de contribution de solidarité auprès de l’Office fédéral de la justice, les dossiers ont pu apporter des preuves à l’injustice subie.

Bases juridiques de l’accès aux dossiers
Le droit d’accès aux dossiers relatifs aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux effectués avant 1981 est régi par la LMCFA depuis 2017. Il est par ailleurs également encadré par les lois cantonales et fédérales sur les archives et la protection des données. Selon la LMCFA, les points de contact cantonaux et les archives cantonales aident les personnes concernées dans la recherche de leurs dossiers. Les personnes concernées doivent pouvoir accéder facilement et gratuitement à leurs dossiers. Elles ont également le droit d’ajouter une note de rectification si elles souhaitent en corriger les contenus. Les proches peuvent aussi consulter les dossiers, à condition que la personne concernée y consente ou soit déjà décédée. La LMCFA indique en outre que les dossiers relatifs aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux doivent être conservés.
Opportunités et risques liés à l’accès aux dossiers pour les personnes concernées
Différentes raisons peuvent pousser les personnes concernées à demander l’accès à leur dossier. Certaines veulent en savoir davantage sur leur passé, d’autres recherchent des proches ou souhaitent comprendre qui est responsable de leur placement ou pourquoi personne ne les a écoutées. Ces dossiers sont souvent les seuls témoignages matériels qui leur restent de leur enfance. Ils peuvent aussi contenir des informations biographiques importantes.
La consultation de leurs dossiers suscite toutefois des sentiments ambivalents chez de nombreuses personnes. Lorsque les dossiers sont fournis, la lecture prend beaucoup de temps et il est souvent difficile de trouver le fil conducteur dans les centaines de pages. Parfois, seuls quelques documents ont été conservés, ce qui laisse de grandes lacunes. Par ailleurs, de nombreuses procédures ou mentions ne sont pas claires et la compréhension du contexte nécessite parfois beaucoup d’efforts. Le contenu et le volume des dossiers peuvent considérablement varier en fonction de la personne qui a rédigé les documents à l’époque. La plupart du temps, différents dossiers ont été conservés à différents endroits et doivent être rassemblés. Dans les copies remises par les archives ou les institutions, des noms ou des passages entiers sont parfois caviardés, afin de protéger les intérêts de tiers. Il est donc important que les copies des dossiers fournies soient accompagnées d’explications.
Enfin, les dossiers contiennent également souvent des appréciations péjoratives des personnes concernées. Certaines sont qualifiées de « psychopathes » et de « débiles », d’autres sont accusées de mentir ou, pour les jeunes femmes en particulier, de constituer un « danger moral ». De telles qualifications peuvent encore causer des souffrances des décennies plus tard et susciter la peur d’une nouvelle intervention des autorités. La recherche a également montré que la lecture d’un langage aussi violent peut entraîner un nouveau traumatisme. Il est donc important que les personnes concernées soient accompagnées par des proches, des spécialistes ou des personnes de référence.

Stigmatisation et discrimination liées aux dossiers
Les dossiers ont toujours été et restent un outil administratif essentiel. Ils garantissent la sécurité juridique, car ils permettent de retracer l’action de l’État et les décisions prises par les autorités. Mais ils peuvent également contribuer à la stigmatisation des personnes concernées par des formulations discriminatoires et des remarques négatives à leur sujet. Cela peut entraîner des préjudices graves, tels que la mise en place injustifiée d’une curatelle. Les dossiers ne se contentent pas de décrire des événements, ils créent aussi des réalités. Ils ont servi de base à des décisions déterminantes. Ainsi, les autorités tutélaires ou les tribunaux compétents à l’époque rendaient leurs décisions essentiellement sur la base de rapports des services ou personnes officiels, sans entendre les personnes concernées elle-mêmes.

Administratif ou le spectre vert. Witzwiler Illustrierte, 1ère année, décembre 1929.
Un artiste interné raconte la vie quotidienne dans l'établissement pénitentiaire de Witzwil à travers des caricatures colorées. Il s'agit probablement d'Emil Rudolf Neuenschwander, qui a été placé à plusieurs reprises sous placement administratif pour « conduite dissolue ».
Image: probablement Emil Rudolph Neuenschwander. Source: Witzwiler-Illustrierte (Vorlagen, Arbeiten von Gefangenen), Jahrgang 1, Dezember 1929, Staatsarchiv des Kantons Bern, BB 4.2.248.

Décision de retrait de la garde prise par l'autorité tutelle de Berne, 1972, page 1.
Source: Collection privée.

Décision de retrait de la garde prise par l'autorité tutelle de Berne, 1972, page 2.
Source: Collection privée.

Décision de retrait de la garde prise par l'autorité tutelle de Berne, 1972, page 3.
Source: Collection privée.

Lettre d'une mère, 1945.
Copie d'une lettre d'une mère dont l'enfant a été placé et est mort.
Source: Akten des Fürsorgeinspektorates (1945), Brief der Mutter, Staatsarchiv des Kantons Bern, StABE BB.1.185.

Troubles nerveux et maladies mentales chez les enfants. 1930.
Série de diapositives sur le thème des soins aux nourrissons. « Alcoolisme chez le père, troubles nerveux et maladies mentales chez les enfants. Seuls les parents ne souffrant eux-mêmes d'aucune affection chronique ont été inclus dans l'étude ». Graphique sur « les troubles nerveux et les maladies mentales chez les enfants en % » en fonction de la « consommation d'alcool du père ».
Dans les dossiers qui circulaient entre les autorités, les tuteurs et les foyers, les hypothèses se transformaient rapidement en faits avérés. Cela était également lié au fait que le droit d’accès aux dossiers a longtemps été appliqué de manière restrictive. Il était donc pratiquement impossible de corriger ces déclarations négatives ou de rectifier les suppositions, puisque les personnes concernées ignoraient ce que les dossiers contenaient à leur sujet. Parallèlement, les dossiers les « accompagnaient » involontairement et souvent à leur insu d’un endroit à l’autre et leur contenu pouvaient ressurgir à tout moment.
Évolution de l’accès aux dossiers
Aujourd’hui, chaque personne a le droit de consulter les dossiers et documents officiels qui la concernent. L’objectif est de garantir la transparence et la traçabilité des activités administratives. Les dossiers contenant des données personnelles sont cependant soumis à des règles de protection particulières. Si des tiers souhaitent avoir accès à ces dossiers, ils doivent justifier leur demande et, dans de nombreux cas, obtenir l’accord de la personne concernée.
Dans le passé, la protection des données personnelles a toutefois également été invoquée pour empêcher ou restreindre la recherche. De nombreuses personnes concernées, qui cherchaient des réponses concernant leur histoire, se sont aussi heurtées à des portes closes pendant des décennies. Ce n’est que récemment que des bases juridiques ont été créées pour réglementer clairement la gestion et la consultation des dossiers. Aujourd’hui, le droit d’accès aux dossiers s’applique aux procédures civiles, pénales et administratives. Il relève du droit d’être entendu et est protégé de la Constitution fédérale.
Malgré cela, les personnes concernées peuvent, encore aujourd’hui, rencontrer des difficultés lorsqu’elles demandent à accéder à leur dossier : la consultation est refusée ou on leur dit que les dossiers n’existent plus. Il est alors important de demander une justification écrite et de rechercher de l’aide auprès des points de contact cantonaux ou des archives cantonales. Les dossiers ont effectivement peut-être été détruits, mais il est aussi possible que les fonds d’archives ne soient pas encore répertoriés ou que la connaissance de la terminologie historique soit insuffisante. Dans de tels cas, les archives de l’État se chargent, pour le compte des personnes concernées, de se renseigner auprès des autorités communales et des institutions privées, d’identifier les lacunes dans la transmission des documents et d’expliquer les bases juridiques.