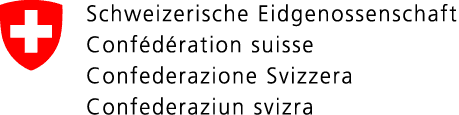Résumé
Hier. Une vue d’ensemble
Jusqu’à la fin du XXe siècle, les autorités suisses ont profondément bouleversé la vie de centaines de milliers de personnes en recourant à des « mesures de coercition à des fins d’assistance et à des placements extrafamiliaux ». Les mesures étaient imposées au nom de l’assistance avec l’objectif de lutter contre la pauvreté et de rétablir l’ordre social. Mais cela a causé beaucoup d’injustice et de souffrance.
Parmi les mesures les plus courantes figuraient le placement des enfants et des adolescents dans des foyers, des établissements d’éducation ou des familles d’accueil. Beaucoup d’entre eux devaient travailler très dur dans des fermes ou des exploitations. Les minorités yéniches et sinti, en particulier ont été ciblées : des enfants étaient retirés à leur famille, puis placés dans des familles d’accueil ou des homes par les autorités et des organisations caritatives.
Il était également courant que des adultes soient placés sans décision judiciaire dans des hospices de pauvres, des établissements d’éducation au travail ou des cliniques psychiatriques. Ces pratiques ont été appelées « internement administratif ». Dans ce cadre, des autorités médicales, communales ou cantonales ont exercé des essais cliniques de médicaments, des stérilisations forcées et contraints des femmes à confier leur enfant à l’adoption.
Certaines personnes ont aussi été victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles extrêmes, ont souffert de la faim, ont été négligées sur le plan sanitaire ou ont été exploitées à des fins économiques.
Les autorités, l’Église et des particuliers portent une forte responsabilité de ces souffrances. Ensemble, elles composaient un système d’assistance complexe, caractérisé par des principes moraux stricts, un faible contrôle des autorités et une logique de réduction des coûts. La collectivité, qui a observé en silence ou détourné le regard, porte également une part de responsabilité.
Il y avait aussi des exceptions. Certains enfants et adolescents ont vécu des expériences positives dans des foyers ou des structures d’accueil, qui les ont rendus plus forts. Ces expériences montrent qu’il était possible, même dans le contexte de l’époque, de créer de conditions propices au bien-être des enfants.
Le nombre de mesures de coercition à des fins d’assistance a diminué de manière constante durant la seconde moitié du XXe siècle. Les critiques ont augmenté, la pauvreté a reculé et la société s’est ouverte. Les internements administratifs ont été délaissés en 1981, après l’adhésion de la Suisse à la Convention européenne des droits de l’homme. Ils ont été remplacés par la privation de liberté à des fins d’assistance, qui apportait une meilleure protection juridique aux personnes concernées. Le travail de mémoire sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux concerne pour cette raison la période avant 1981.
Aujourd’hui. Conséquences et travail de mémoire
Les mesures de coercition à des fins d’assistance ont très souvent eu des conséquences lourdes qui ont marqué durablement la vie des personnes concernées. Elles-mêmes ainsi que leur descendance en ressentent encore les effets aujourd’hui.
La recherche montre que les personnes ayant subi des violences souffrent souvent de troubles psychiques, de douleurs chroniques, de difficultés financières, d’un niveau de formation moins élevé et d’exclusion sociale. Pour la société, les conséquences sont par exemple des coûts de santé plus élevés et la reproduction d’inégalités sociales.
Un large débat politique sur ce thème a débuté en Suisse dans les années 1990. Avec la « loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 », la Suisse dispose depuis 2017 d’une base légale qui reconnaît l’injustice et la souffrance subie et qui permet de verser une contribution de solidarité aux victimes.
Les cantons et les communes ainsi que les églises nationales et d’autres organisations et fondations participent aussi au travail de mémoire. Ils bâtissent des monuments commémoratifs et sensibilisent le public aux injustices commises.
Dans le cadre du travail de mémoire, les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux ont également fait l’objet d’études scientifiques. Deux importants projets de recherche nationaux ont notamment analysé ces thématiques pendant des années. Les résultats de la recherche sont accessibles au public, par exemple grâce à la base de données de cette plateforme web.
La Suisse n’est pas le seul pays à se pencher sur les injustices historiques. Au niveau international, on constate que les mécanismes, les expériences vécues par les personnes concernées et les types de violence subis se ressemblent fortement, malgré des situations de départ différentes.
De nombreux pays s’efforcent de faire évoluer leur patrimoine mémoriel. Les personnes qui étaient autrefois systématiquement marginalisées et défavorisées doivent pouvoir s’exprimer et trouver leur place dans la société et dans la mémoire culturelle commune.
Et demain ? Reconnaître, transmettre, repenser
Ce ne sont pas seulement les personnes concernées et leurs proches qui ressentent les conséquences des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux, mais aussi la société d’aujourd’hui. En nous confrontant à l’histoire, nous avons cependant l’opportunité de tirer des leçons des erreurs passées.
La Confédération verse aux victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux une contribution de solidarité de 25 000 francs. Cette contribution de solidarité est une reconnaissance symbolique de l’injustice subie et permet à de nombreuses victimes de réaliser parfois pour la première fois de leur vie un souhait important. Elle reste cependant limitée et ne permet pas améliorer durablement les conditions de vie.
Dans chaque canton, il existe des points de contact et des services d’archives qui aident les personnes concernées à déposer une demande de contribution de solidarité et à mener un travail de mémoire personnel.
Il est très important que ce chapitre de l’histoire suisse soit connu de toutes et tous, y compris des générations futures. La transmission joue donc un rôle important. Le programme « se souvenir pour l’avenir », qui comprend cette plateforme web, une exposition itinérante, des offres pour les écoles et de nombreuses autres activités, est une contribution de la Confédération à cet objectif.
À cause de leurs mauvaises expériences avec les institutions et les espaces de vie collectifs, de nombreuses personnes concernées ne peuvent s’imaginer entrer dans une maison de retraite. Leurs enfants et petits-enfants sont aussi souvent profondément marqués par ces expériences, même si les personnes concernées n’en ont jamais directement parlé. Sur cette plateforme web, vous trouverez un aperçu des différentes offres de soutien proposées pour les personnes concernées, ainsi que des indications à destination du personnel des secteurs du social et de la santé.
Aujourd’hui encore, il existe des mesures de contrainte et des placements hors du foyer familial (nom actuel donné aux placements extrafamiliaux). Mais depuis les années 1980, la situation juridique et la jurisprudence ont évolué en Suisse.
La protection de l’enfant et de l’adulte se concentre aujourd’hui sur la prise en charge, le soutien et la protection des personnes qui ont besoin d’aide.
Lorsque le bien-être d’un enfant est menacé et que ses parents ne peuvent pas améliorer la situation par leurs propres moyens, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) prend la mesure de soutien la moins contraignante possible. Le but n’est pas de retirer la responsabilité aux parents, mais de trouver des solutions communes. Le placement d’un enfant hors de sa famille n’est envisagé qu’en dernier recours.
Pour les adultes, il existe différentes formes de curatelles destinées à les aider à gérer leur affaires courantes. En principe, seule une personne souffrant d’importants troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon peut être placée dans un établissement qui doit être adapté. Et ce uniquement s’il n’y a pas d’autre solution et qu’une mesure moins lourde ne suffit pas.
Les mesures de contrainte, qui sont prises contre la volonté de la personne concernée et qui restreignent sa liberté personnelle, n’existent pas qu’en droit civil, mais aussi en droit pénal, en droit d’asile et en droit des étrangers.
Les institutions d’exécution des peines et le travail social sont devenus plus transparents et plus ouverts. Les droits des personnes concernées, par exemple les possibilités de recours, ont été renforcés. La pratique actuelle continue toutefois d’évoluer et doit encore faire face à de nombreux défis. Le respect de la dignité humaine et de l’État de droit est ici essentiel.
La confrontation avec l’histoire montre que, chaque fois qu’une société intervient dans la vie de ses membres, une tension apparait entre aide et contrôle. Qui est considéré comme ayant besoin d’aide ou de protection ? Dans quelle mesure pouvons-nous déterminer notre propre vie ? Quels sont nos droits et comment s’assurer qu’ils sont respectés ? Et où l’État intervient-il ? Nous devons continuer à poser ces questions et à en discuter.